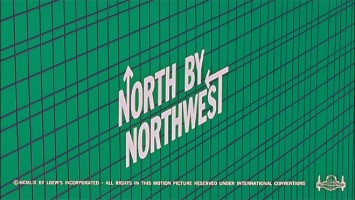- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- La mort aux trousses, de Alfred Hitchcock (USA, 1959)
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!
Où ?
A la cinémathèque
Quand ?
Lundi soir, donc plus tard que Soupçons et L’ombre d’un doute dont je n’ai pas encore fini les chroniques…
Avec qui ?
MaFemme, mon compère de cinémathèque et MonFrère arrivé à la dernière minute
Et alors ?
Ce ne sont pas les films d’espionnage qui manquent dans la filmographie de Hitchcock ; il en a réalisé dès 1934 (L’homme qui en savait trop), et son antépénultième long-métrage, L’étau, appartenait encore à ce genre. Qu’est-ce qui fait alors que La mort aux trousses trône de manière si indéboulonnable au sommet de cette troupe de prétendants ? La réponse évidente est sa démesure. Le générique d’ouverture, qui s’affiche de manière spectaculaire sur un quadrillage déformé dont on comprendra qu’il s’agit de la façade vitrée d’un gratte-ciel de New York, et les premiers plans filmés dans cette même ville à l’heure de la sortie des bureaux et grouillant de monde, donnent le ton : La mort aux trousses est une œuvre née sous le signe du vertige. Une fois l’engrenage fou enclenché, par une amorce minuscule (une erreur sur la personne) mais aux effets incontrôlables, plus rien n’est en mesure d’entraver la profusion hitchcockienne de travellings millimétrés, de hors-champ créateurs de tension et de plans outrageusement larges1. Ces éléments typiques et suprêmes de la syntaxe cinématographique du réalisateur, qui d’ordinaire trouvent une ou deux occasions d’intervenir par film, en ont ici une ou deux par séquence car 2h15 durant le spectacle et l’adrénaline sont les seules aspirations du script. Avec une telle opulence d’opportunités, et des moyens matériels qui vont de pair, il n’est pas étonnant que les scènes les plus insensées de La mort aux trousses (le meurtre à l’ONU, l’attaque de l’avion épandeur au milieu de nulle part, la course-poursuite finale sur le mont Rushmore2) soient entrées au panthéon des moments de cinéma les plus fameux – et je ne parle pas simplement de cinéma de genre, mais de cinéma tout court.
La contrepartie de ce droit au feu d’artifice permanent est une frivolité certaine du propos. Une intrigue qui s’évertue à mettre en place un tel grand huit de péripéties doit y sacrifier l’intégralité de son sérieux (le face-à-face entre le héros et l’avion est, selon une approche de raison, absolument aberrant), ce qui fait toute la différence entre La mort aux trousses et L’homme qui en savait trop, par exemple. Mais La mort aux trousses est précisément un grand film car, loin de perdre son âme dans ce marché faustien, il parvient à gagner sur les deux tableaux en retournant à son avantage son insouciance et son invraisemblance. Il ouvre de la sorte la voie à un nouveau genre, promis par la suite à un avenir florissant : le film d’espionnage alternatif, mi-sérieux mi-parodique. Hitchcock a eu l’intuition de saisir cette futilité de l’histoire de La mort aux trousses, pur divertissement ne reposant sur aucune base solide3, éloge effronté de l’inconséquence qui ose se désintéresser des tenants et aboutissants de la Guerre Froide et réduire celle-ci à la toile de fond d’un long et sensuel flirt amoureux. Le cinéaste prend soin de ne jamais laisser s’installer la gravité qui pourrait aller de pair avec le contenu de telle ou telle scène, une règle qui s’étend jusqu’aux deux meurtres montrés à l’écran et dédramatisés dans l’instant.
 L’essentiel du temps, pour détourner l’attention Hitchcock s’en remet au cabotinage brillant de Cary Grant, auteur d’un incroyable numéro comique. Et lorsque vient son tour de mettre effectivement la main à la pâte, il le fait lui aussi avec classe, par des astuces de mise en scène de premier choix, telle l’ellipse de dénouement, probablement la plus osée de l’histoire du cinéma d’aventures. Les méandres sans fin du scénario, qui octroie à chaque personnage majeur une double voire triple identité, ont également leur part dans cet enivrant numéro de voltige. Ils ouvrent par ailleurs une autre brèche dans le cadre établi du film d’espionnage, en l’amenant sur le terrain – aujourd’hui densément occupé, à l’époque quasiment vierge – des doutes sur l’identité. [spoilers] Ce ne sont encore dans La mort aux trousses que des frôlements, mais le vertige se fait sentir ici aussi : le héros, Roger O. Thornhill, est un être à l’identité mal définie4, qui se retrouve à être confondu avec un autre, qui en réalité n’existe pas, et que Roger va se mettre à incarner d’abord par jeu puis pour de bon, et publiquement. Quand au personnage féminin placé sur sa route, Eve Kendall (Eva Marie Saint), elle est d’abord innocente, puis agent d’un des deux camps, puis de l’autre… Seule ancre au milieu de ce maelström identitaire prémonitoire des obsessions modernes, l’affection que se portent les deux héros – l’éternel « boy meets girl » de Hitchcock, véritable fil directeur du film et d’une solidité à toute épreuve. La manière dont le dernier acte de l’intrigue rebondit spectaculairement dans une toute autre direction, sur la seule base de cette intensité amoureuse, en est l’éclatante démonstration. Quant à l’écriture subtile et savoureuse des dialogues qui scandent le jeu de séduction entre Eve et Roger, elle est la digne héritière des meilleures screwball comedies, et la dernière composante de l’apothéose cinéphile que constitue La mort aux trousses.
L’essentiel du temps, pour détourner l’attention Hitchcock s’en remet au cabotinage brillant de Cary Grant, auteur d’un incroyable numéro comique. Et lorsque vient son tour de mettre effectivement la main à la pâte, il le fait lui aussi avec classe, par des astuces de mise en scène de premier choix, telle l’ellipse de dénouement, probablement la plus osée de l’histoire du cinéma d’aventures. Les méandres sans fin du scénario, qui octroie à chaque personnage majeur une double voire triple identité, ont également leur part dans cet enivrant numéro de voltige. Ils ouvrent par ailleurs une autre brèche dans le cadre établi du film d’espionnage, en l’amenant sur le terrain – aujourd’hui densément occupé, à l’époque quasiment vierge – des doutes sur l’identité. [spoilers] Ce ne sont encore dans La mort aux trousses que des frôlements, mais le vertige se fait sentir ici aussi : le héros, Roger O. Thornhill, est un être à l’identité mal définie4, qui se retrouve à être confondu avec un autre, qui en réalité n’existe pas, et que Roger va se mettre à incarner d’abord par jeu puis pour de bon, et publiquement. Quand au personnage féminin placé sur sa route, Eve Kendall (Eva Marie Saint), elle est d’abord innocente, puis agent d’un des deux camps, puis de l’autre… Seule ancre au milieu de ce maelström identitaire prémonitoire des obsessions modernes, l’affection que se portent les deux héros – l’éternel « boy meets girl » de Hitchcock, véritable fil directeur du film et d’une solidité à toute épreuve. La manière dont le dernier acte de l’intrigue rebondit spectaculairement dans une toute autre direction, sur la seule base de cette intensité amoureuse, en est l’éclatante démonstration. Quant à l’écriture subtile et savoureuse des dialogues qui scandent le jeu de séduction entre Eve et Roger, elle est la digne héritière des meilleures screwball comedies, et la dernière composante de l’apothéose cinéphile que constitue La mort aux trousses.
1 ces derniers rendant le visionnage du film sur un grand écran de cinéma obligatoire
2 ces trois scènes ont en commun l’emploi d’un même procédé à la rigueur et à l’efficacité imbattable : faire d’une chose tout d’abord fondue dans le décor au point d’en être insignifiante (resp. les flashs de l’appareil photo, l’avion et les hommes de main descendant par d’autres flancs de la montagne) l’élément majeur du climax de la séquence, dans un mouvement de rapprochement soudain
3 même son titre original (North by northwest) est sans signification véritable
4 on l’entraperçoit à peine au travail, ou avec un proche – sa mère –, et dans son nom le O. « stands for nothing »