- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- Transformers, de Michael Bay (USA, 2007)
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!
Chez un copain, en Blu-ray
Quand ?
Mardi soir
Avec qui ?
L’hôte de la soirée, et deux autres potes qui avaient déjà vu la chose
Et alors ?
On avait quitté l’inénarrable Michael Bay sur le bancal The island, qui trois-quarts d’heure durant représentait ce que le cinéaste a fait de mieux (et en ferait presque un
réalisateur de science-fiction crédible – presque) avant de se replonger de plus belle dans la crétinerie débilitante, sous-sous-sous-genre du blockbuster hollywoodien pour lequel son don est
quasiment inégalé. La recette est simple, comme celle d’un quatre-quarts : un quart d’intrigue au ras des pâquerettes, un quart de personnages fadasses débitant à la chaîne des punch
lines miteuses, un quart d’effets spéciaux à la pointe des avancées technologiques, et un quart de montage épileptique – jamais plus de deux secondes entre deux coupes, si possible qui
relient des plans n’étant pas supposés s’enchaîner. Tous ces ingrédients sont plus que jamais présents dans Transformers, même si Michael Bay aurait pu un peu plus mélanger la
pâte avant de la mettre au four. La première moitié du film fait surtout la part belle à l’intrigue (disons plutôt à son absence) et aux personnages, et la seconde est une démonstration de force
à base d’images de synthèse – la bataille rangée finale, sorte de Chute du faucon noir délirante avec des robots géants qui détruisent la plus grande partie de Downtown Los
Angeles, est particulièrement ébouriffante.
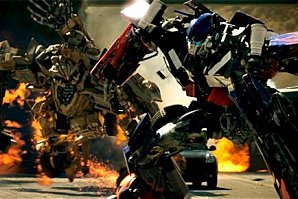
Transformers se positionne cependant légèrement en marge du reste de la filmographie de Bay, pour une raison qui commençait à
émerger dans The island : le cinéaste assume enfin pleinement qu’il n’a jamais quitté la préadolescence (et ce n’est pas dans ses plans à court terme, puisque son nouveau
film qui sort cet été est… Transformers 2). Dans The island, cela se traduisait par une scène de dépucelage intégrant tous les clichés du fantasme adolescent
basique ; dans Transformers, c’est l’intégralité du film qui est parasitée par cette orientation. Au-delà des bêtises habituelles sur la sauvegarde du monde contre une agression
extérieure dévastatrice, la finalité primaire du scénario consiste en effet à savoir si le héros lycéen parviendra oui ou non à choper la plus belle fille de la classe, malgré son physique
quelconque, ses parents pot-de-colle et sa timidité maladive. Rôle pour lequel Shia LeBouf (L’œil du mal) fait un interprète idéal, tout à fait crédible en dépositaire des réminiscences de l’ado geek et frustré que devait
être Michael Bay.

Le cinéaste consacre, au bas mot, les deux-tiers de son film à ce flirt. Il bâcle au passage les passages imposés à la gloire de la toute-puissance
militaire des Etats-Unis – les dites scènes devenant du coup comiques plutôt qu’horripilantes, à force de dilettantisme et d’incohérences même pas camouflées. Bay va jusqu’à mettre à
contribution ses gros jouets transformables et mécanisés dans cette tentative de drague aux dimensions faramineuses, le temps d’une séquence hallucinante où les robots deviennent les acteurs
d’une partie de cache-cache dans et autour de de la maison du héros. Michael Bay devrait faire attention ; à ce rythme-là, il passera bientôt pour un auteur. Premier signe, son
Transformers n’est pas classé dans la catégorie « navets et déceptions » de ce blog, là où tout le monde l’attendait, mais parmi les « blockbusters déviants ».


moi, je l’aurais classé dans « Nouvelle vague », mais bon…
(c’est mon plaisir coupable, Transformers…)