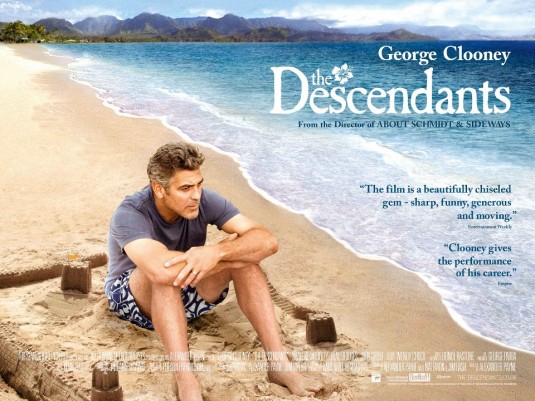- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- The descendants, d’Alexander Payne (USA, 2011)
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!
A l’Everyman Baker street, à Londres
Quand ?
Vendredi après-midi, à 16h
Avec qui ?
Seul
Et alors ?
Voici donc le co-favori (avec The artist et sa combinaison irrésistible pour Hollywood de classe française et de célébration de l’âge d’or du cinéma américain) des Oscars de cette année. S’il gagne, cela fera une raison de se souvenir de l’existence de The descendants. Dans le cas contraire, il sera bien vite oublié, n’ayant rien de notable à son actif autant qu’à son passif. Possédant suffisamment de qualités pour ne pas être mauvais, The descendants souffre de manques et de limites qui l’empêchent pour autant d’être bon. Il passe sans accroc et sans laisser de trace après s’être retiré.
 Matt King (George Clooney) habite Hawaii. Cette donnée est en lien direct avec le premier problème qui occupe sa vie, la décision de céder à un promoteur immobilier plusieurs hectares de terre vierge – et paradisiaque – appartenant à sa famille, qui descend des premiers colons blancs arrivés dans l’archipel. Vivre à Hawaii n’a par contre aucun rapport avec le second drame de Matt, plus soudain et plus grave, qu’est le coma irréversible dans lequel est plongée sa femme suite à un accident de bateau, hormis le fait que les adieux et le prélude du deuil se font en chemisette à fleurs, bermuda de plage, pieds nus ou chaussés de tongs. Alexander Payne, réalisateur et scénariste, étend cette ambiance particulière à tout le film. Il fait de The descendants un drame dédramatisé, où les conflits et les infortunes se vivent sans véritable tumulte ni scandale, mais dans une douce étrangeté. Des crises d’adolescence surgissent des copains dadais mais lucides, la vente des terrains se fait au détour d’un barbecue réunissant tous les cousins éloignés, le deuil infuse lentement et presque naturellement.
Matt King (George Clooney) habite Hawaii. Cette donnée est en lien direct avec le premier problème qui occupe sa vie, la décision de céder à un promoteur immobilier plusieurs hectares de terre vierge – et paradisiaque – appartenant à sa famille, qui descend des premiers colons blancs arrivés dans l’archipel. Vivre à Hawaii n’a par contre aucun rapport avec le second drame de Matt, plus soudain et plus grave, qu’est le coma irréversible dans lequel est plongée sa femme suite à un accident de bateau, hormis le fait que les adieux et le prélude du deuil se font en chemisette à fleurs, bermuda de plage, pieds nus ou chaussés de tongs. Alexander Payne, réalisateur et scénariste, étend cette ambiance particulière à tout le film. Il fait de The descendants un drame dédramatisé, où les conflits et les infortunes se vivent sans véritable tumulte ni scandale, mais dans une douce étrangeté. Des crises d’adolescence surgissent des copains dadais mais lucides, la vente des terrains se fait au détour d’un barbecue réunissant tous les cousins éloignés, le deuil infuse lentement et presque naturellement.
 Cette voie de l’incertitude entre les larmes et le rire, la douceur et la douleur, ne surprend pas. Payne l’approfondit de film en film, toute sa carrière étant balisée par le goût pour le décalage, le crochet. Le talent de Payne scénariste dans cet exercice est indéniable, dans la composition de l’intrigue et des séquences qui la constituent (la recherche de l’amant de son épouse, dont Matt apprend l’existence une fois celle-ci cliniquement morte, est joliment tournée en une enquête façon film noir) comme dans l’écriture des dialogues. Ciselés avec soin, riches, ceux-ci font vivre d’un bout à l’autre le plaisir du verbe – à ne pas confondre avec celui, plus étriqué, du bon mot. Dommage que Payne persiste, là aussi film après film à ne pas mettre autant d’engouement et d’inspiration dans sa mise en scène. L’insignifiance de celle-ci est caractéristique des films de scénaristes, qui n’y voient qu’un moyen fonctionnel de mettre leur prose à l’écran. Perdus au milieu d’une lumière accessoire, d’une bande-son de supermarché et de cadrages banals, les moments de mise en scène dans The descendants se comptent sur les doigts d’une main (et encore pas tous).
Cette voie de l’incertitude entre les larmes et le rire, la douceur et la douleur, ne surprend pas. Payne l’approfondit de film en film, toute sa carrière étant balisée par le goût pour le décalage, le crochet. Le talent de Payne scénariste dans cet exercice est indéniable, dans la composition de l’intrigue et des séquences qui la constituent (la recherche de l’amant de son épouse, dont Matt apprend l’existence une fois celle-ci cliniquement morte, est joliment tournée en une enquête façon film noir) comme dans l’écriture des dialogues. Ciselés avec soin, riches, ceux-ci font vivre d’un bout à l’autre le plaisir du verbe – à ne pas confondre avec celui, plus étriqué, du bon mot. Dommage que Payne persiste, là aussi film après film à ne pas mettre autant d’engouement et d’inspiration dans sa mise en scène. L’insignifiance de celle-ci est caractéristique des films de scénaristes, qui n’y voient qu’un moyen fonctionnel de mettre leur prose à l’écran. Perdus au milieu d’une lumière accessoire, d’une bande-son de supermarché et de cadrages banals, les moments de mise en scène dans The descendants se comptent sur les doigts d’une main (et encore pas tous).
 Le précédent – et à ce jour meilleur – long-métrage de Payne, Sideways, présentait déjà cette carence formelle. Mais la remarquable densité de son récit compensait largement. Autour du personnage de Matt, sur lequel il n’y a rien à redire dans l’écriture comme dans le jeu, The descendants manque de matière pour reproduire le même tour de force. Matt est seul à tenir le film sur ses épaules alors qu’ils étaient deux aux avant-postes de Sideways ; et les seconds rôles qui l’entourent, pourtant intéressants et bien castés (Robert Forster, Matthew Lillard, Judy Greer…), restent assez tristement à l’état d’esquisse. Campé sur son unique ligne droite narrative, à l’horizon très proche, The descendants ne peut être plus qu’une petite histoire, touchante, dotée d’une jolie pirouette finale, mais en définitive bien anecdotique.
Le précédent – et à ce jour meilleur – long-métrage de Payne, Sideways, présentait déjà cette carence formelle. Mais la remarquable densité de son récit compensait largement. Autour du personnage de Matt, sur lequel il n’y a rien à redire dans l’écriture comme dans le jeu, The descendants manque de matière pour reproduire le même tour de force. Matt est seul à tenir le film sur ses épaules alors qu’ils étaient deux aux avant-postes de Sideways ; et les seconds rôles qui l’entourent, pourtant intéressants et bien castés (Robert Forster, Matthew Lillard, Judy Greer…), restent assez tristement à l’état d’esquisse. Campé sur son unique ligne droite narrative, à l’horizon très proche, The descendants ne peut être plus qu’une petite histoire, touchante, dotée d’une jolie pirouette finale, mais en définitive bien anecdotique.