- Accueil
- Dans les salles
- Cinéastes
- Pas morts
- Vivants
- Abdellatif Kechiche
- Arnaud Desplechin
- Brian de Palma
- Christophe Honoré
- Christopher Nolan
- Clint Eastwood
- Coen brothers
- Darren Aronofsky
- David Fincher
- David Lynch
- Francis Ford Coppola
- Gaspar Noé
- James Gray
- Johnnie To
- Manoel de Oliveira
- Martin Scorsese
- Michael Mann
- Olivier Assayas
- Paul Thomas Anderson
- Paul Verhoeven
- Quentin Tarantino
- Ridley Scott
- Robert Zemeckis
- Roman Polanski
- Steven Spielberg
- Tim Burton
- USA
- France
- Et ailleurs...
- Genre !
- A la maison
- Mais aussi
- RSS >>
- Dark city, de Alex Proyas (USA, 1998)
Je like cet article sur les réseaux sociaux de l'internet!

Où ?
En DVD zone 2 anglais, réédité l’an dernier dans une version director’s cut agrémentée de nouveaux bonus (documentaire et commentaires audio).
Quand ?
Le week-end dernier
Avec qui ?
Seul
Et alors ?
Le buzz qui avait entouré Dark city au moment de sa sortie il y a un peu plus d’une décennie, déjà sérieusement entamé par la déferlante Matrix sur le
même terrain du film d’anticipation visionnaire et paranoïaque l’année suivante, est définitivement de l’histoire ancienne. La preuve en est la sortie en catimini l’été dernier de cette édition
DVD director’s cut en Angleterre – DVD qui semble bien ne jamais devoir voir le jour dans une version française. Jusqu’au bout, Dark city aura donc pris à revers la
machine commerciale hollywoodienne, et s’y sera brûlé les ailes. A l’opposé des montages inédits gadgets qui ne servent qu’à booster les ventes de n’importe quel DVD de blockbuster dès la
première édition, cette version longue est une réelle renaissance de la vision originelle du réalisateur Alex Proyas ; mais elle sort bien trop tard.

De la même manière, il y a douze ans de cela, Proyas avait tenté contre vents et marées de mener à l’écran son ambitieux et sans concessions script de jeunesse. Au terme d’une production
chaotique, relatée dans un documentaire inédit qui accompagne le film sur ce DVD (changement de studio, budget serré et dépassements de tournage), Proyas se retrouva avec sur les bras une
voix-off imposée par le studio – car les spectateurs ne comprenaient pas tout dès le début… mais ils s’en accommodaient très bien – et une diffusion en salles massacrée, qui fit du film un four
au box-office. L’accueil fut meilleur en Europe, grâce au passage hors compétition à Cannes, et les qualités évidentes de Dark city lui ouvrirent une belle deuxième vie en DVD.
Cette director’s cut aurait dû être la troisième, car elle change effectivement le long-métrage de manière non négligeable, en y réintégrant des éléments intéressants – la fille de la
prostituée rencontrée au début par le héros, les empreintes digitales en forme de spirales… – et en se débarrassant de l’introduction en voix-off. Même lorsque l’on connaît le film sur le bout
des doigts, l’effet de ce retrait est indéniable : les plans inauguraux de la voûte étoilée et des immeubles de la ville, le sourire énigmatique du Docteur Schreber (génial Kiefer
Sutherland), le démarrage soudain du générique transporté par le thème spectaculaire de Trevor Jones prennent alors une toute autre dimension, menaçante et vertigineuse.

A revoir le film « à froid », certaines choses dans Dark city paraissent approximatives, surtout dans la conduite du récit. Obsédé par sa propre vitesse, celui-ci
délaisse le développement de ses personnages secondaires, ne prend pas toujours la peine de bien poser les tenants et aboutissants de son fil directeur, et à l’opposé se lance soudainement sur
des chemins de traverse (le Stranger à qui l’on inocule des souvenirs du héros humain, le final à la Akira) explorés plus profondément qu’il ne serait nécessaire. Ces
carences ôtent une partie de l’enthousiasme débordant éprouvé à la première vision du film ; mais elles ne ternissent pas le principal, à savoir l’inépuisable pouvoir d’évocation qui se
dégage de Dark city. Les autres suppléments, documentaires et commentaires audio, apportent un éclairage fructueux sur cette force, issue tout droit de l’univers fourmillant,
disparate et à double fond créé en même temps que le film.

Un univers dont les ascendances et les populations alimentent quantité de conjectures se rattachant à des questions philosophiques fondatrices et intemporelles. Tel intervenant déclare ainsi dans
les bonus que la ville de Dark city est à la fois un cocon nourricier et une prison ; elle est l’horizon ultime de ses habitants, comme cela était le cas avant la révolution
industrielle, quand voyager même sur quelques kilomètres constituait un luxe. Tel autre insiste quant à lui sur la manière dont la quête d’identité de ces habitants schizophrènes malgré eux
(puisque leur vie change du tout au tout chaque jour) résonne avec les errements du monde occidental contemporain réel. Lequel monde est finalement lui aussi l’objet d’un contrôle et d’un
« tuning » quotidien par les responsables marketing et autres spin doctors… Se pose alors la question du genre d’un film qui à l’usage tendrait plus vers la comédie
sociologique grinçante que vers le mélange de film noir et de science-fiction vendu sur le papier.
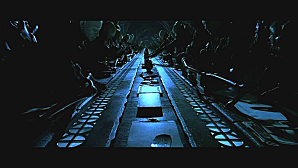
Pour ma part, j’ai une troisième piste d’analyse à soumettre : Dark city comme expression fantasmée du rapport entretenu vis-à-vis de l’industrie du cinéma par le jeune débutant
Alex Proyas qui écrivit le script. Une industrie personnifiée par les Strangers, ces tous-puissants executive men de studio – la ville – qui modèlent à leur guise les existences
de leurs acteurs – les habitants – en usant des différents départements travaillant pour eux et uniquement pour eux : scénario (la création de souvenirs préfabriqués et injectés dans la mémoire
des acteurs), décors et accessoires, effets spéciaux (le remodelage régulier des bâtiments de la ville)… En rupture avec l’attitude de Schreber, psychologue génial collaborant avec l’ennemi
pour poursuivre ses recherches – soit l’équivalent d’un auteur indépendant de talent se vendant à Hollywood pour s’assurer de faire des films sans souci financier, quelle que soit la qualité des
œuvres ainsi produites -, Alex Proyas se rêve en John Murdoch (Rufus Sewell), le héros de l’histoire. Il renverse l’hégémonie des Strangers, et prend possession de leurs moyens
techniques et matériels, du studio, pour créer un univers personnel, rompant avec les règles préétablies et osant prendre des risques, s’ouvrir aux forces extérieures. C’est l’alternance
jour-nuit réhabilitée et non contrôlée, ou encore la réalisation de Shell Beach, plage débordant symboliquement de l’ancien mur d’enceinte de la ville pour édifier une passerelle vers l’inconnu.
C’est enfin, et surtout, accoucher d’un film démarrant dans des genres ultra-codifiés et s’achevant sur un plan renversant de clarté, d’optimisme, de sérénité.

Malheureusement, on sait ce qu’il advint d’Alex Proyas après cet époustouflant plaidoyer : il a vite abandonné la voie ardue et risquée d’un Murdoch, pour devenir un Schreber, ravi de sa petite
carrière tranquille passée à exécuter les ordres des studios. Après Prédictions, qui sait quelle prochaine couleuvre il acceptera d’avaler.

Tu remates l’incroyable Dark City « seul », sans me prévenir ?
T’es plus mon frère D:
Marrant, ta troisième interprétation.
Pour ma part, j’ai vu le film sur le tard, et j’ai été un peu déçu par rapport à tout le bien qu’on m’en disait: Sutherland qui roule des yeux et cabotine, Sewell un peu fadasse, et Connelly qui paie son 3eme tiers. Ca m’énerve de ne pas rentrer dans le film, car j’ai l’impression de passer à côté de qq chose (un peu comme pour le 13eme Guerrier, tiens…)
B.